La genèse tortueuse du Human Brain Project, cette entreprise technologique européenne gigantesque initiée par l’EPFL, a passé il y a quelques jours une étape qui fait perdre justement à l’EPFL la direction du projet.
PAR PIERRE KOLB
Pour ceux que cela surprendrait, il faut noter que ce désaisissement, qui reste à confirmer, n’a pas donné lieu aux mêmes coups de clairons que ceux répercutés par les médias lorsque la haute école de Lausanne avait décroché ce mandat. La décision annoncée la semaine dernière est la dissolution du triumvirat de direction contre lequel s’étaient élevés passés 750 chercheurs, qui se se sont pas tellement pris aux personnes qu’à leur gestion opaque de l’affaire. La réorganisation qui devrait s’ensuivre va très loin puisque, mezzo voce, le patron de l’EPFL interrogé par le «Temps», Patrick Aebischer, avait reconnu le 10 février qu’il faudra mettre en place «une structure moins centralisée mais plus continentale, au prix de considérer l’EPFL comme une des antennes du projet et plus son siège». On attend encore des précisions, entre autres sur la répartition des crédits de ce jackpot qui n’a plus l’air de l’être pour Lausanne.
Il n’en reste pas moins qu’au moment où il est nommé dans des conseils d’administration de multinationales avant même son départ effectif, annoncé pour l’an prochain, le patron ne finit pas son règne en apothéose; ce qui eût été le cas si l’opération «HBP» avait pu se développer selon ses idées. Cet échec va-t-il influencer sa succession? C’est à espérer au sens où, à l’heure des bilans, on devrait en revenir aux questions lancinantes qui, bien qu’en sourdine, n’ont cessé d’accompagner l’impressionnant développement de l’EPFL.
Ces questions ont surtout été posées par le professeur Libero Zuppiroli, ainsi qu’il le fit il y a cinq ans dans son langage imagé: «L’EPFL était une femme en pleine maturité, ayant beaucoup de classe, d’humanité, de pudeur. On l’a surmaquillée, on a raccourci ses jupes». Il critiquait le modèle américain copié par la direction de l’EPFL, mais pas seulement: une politique voulue en haut lieu en Suisse et en Europe. Il la qualifie de violente. «Elle ressemble à la politique appliquée dans les grandes entreprises. Elle repose sur le contrôle, et une défiance à l’égard des chercheurs. Lorsque l’expérience a débuté à l’EPFL, le modèle managérial et boursier avait le vent en poupe, à l’image de la bulle internet: il n’est pas étonnant que les politiques aient voulu donner ce modèle à une université. Aujourd’hui, la situation a changé.»
Zuppiroli ne prétend pas que les universités américaines en cause soient mauvaise. «Mais il faut voir les valeurs sur lesquelles elles sont fondées. Ce sont des citadelles du fric. Elles ont comme religion la compétition, le leadership. Les études y coûtent très cher. Et elles développent un modèle de professeur intéressé à collecter de l’argent, à publier dans les meilleures revues… pour qui l’enseignement n’est pas la première priorité. A certains moments, il est même méprisé. On est loin de ce que je défends, une université comme service public, destinée à augmenter les capacités culturelles de la population et à dégager des élites qui doivent servir le pays.»
On ne doit pas former des moutons, note-t-il, mais des esprits critiques: «En recourant à l’histoire des sciences. Et en interrogeant, au-delà de la fascination pour la matière et ses propriétés, les conséquences écologiques, par exemple, de certains développements. Cela, évidemment, prend du temps.»
Il y a aussi la montagne de questions déontologiques posées par les collaborations avec l’économie. Des problèmes apparus aigus ces derniers temps avec la découverte des droits de regard de Nestlé, mais pas seulement, si l’on pense aux problèmes cruciaux posés par la collaboration de Syngenta avec l’EPFZ. Si l’EPFL s’est distinguée par une sorte de fuite en avant dans ce domaine, la dérive est généralisée qui fait se poser la question: quelqu’un serait-il capable de chasser les marchands du Temple? Cela paraît mission impossible. Mais Libero Zuppiroli donne une piste en se plaçant dans une perspective de rééquilibrage: «Puisqu’elles augmentent leurs recettes de fonds privés, les universités pourraient, par exemple, dégager davantage de ressources publiques pour mieux développer la formation. Recruter des gens différents, selon d’autres critères. Et redonner confiance aux gens, qui se sentent seuls, et qui doutent d’eux-mêmes.»
Rappel utile dans ce contexte. La sortie du nucléaire débattue aujourd’hui est l’aboutissement du long combat des antinucléaires dont la plus importante manifestation fut en 1975 l’occupation du site de Kaiseraugst. Cet ample mouvement populaire avait besoin d’une crédibilité scientifique, et il l’eut grace à l’engagement de quelques universitaires. Et particulièrement du professeur de physique nucléaire Jean Rossel, à l’université de Neuchâtel. L’activité d’un physicien indépendant du lobby nucléaire aurait-elle été possible sans l’existence d’une petite université disposant encore d’autonomie, capable de ce fait de recruter «des gens différents»?
S’il a paru bien isolé avec ses questions dérangeantes, Zuppiroli trouve aujourd’hui quelque écho à des niveaux officieux qui font que le pire n’est pas forcément sûr. Ainsi cette réflexion développée, en décembre dernier, dans la revue «Horizons» du Fonds national de la recherche, par Pius Knüsel. Directeur de l’université populaire de Zurich, ancien directeur de Pro Helvetia, il part d’une critique de la politique culturelle qui l’avait amené à quitter Pro Helvetia, et d’expériences régionales, pour observer: «Quand il est question de politique, de culture, d’éducation et de santé, on parle de «communication», parce que cela fait plus classe. Depuis que je travaille dans la formation pour adultes, les magazines universitaires s’empilent sur mon bureau. Ils décrivent une pléthore de projets de recherche exceptionnellement utiles. A cela s’ajoutent les invitations aux science days, «science slams», nuits de la recherche, journées portes ouvertes, après-midis pour enfants, festivals de formation. Une palette d’offres s’est créée autour de la science. On veut prouver au public à quel point on est utile. On souhaite générer de l’attention, suggérer de l’importance, présenter la science comme une expérience séduisante, presque comme un divertissement qui produit de la connaissance en passant.
Cette culture florissante des relations publiques déforme l’image de ce dont elle parle. Elle gonfle l’importance des hautes écoles. Elle réduit la science à quelques amabilités. Elle esthétise la recherche. Et elle transforme les universités en marques concurrentes. Elle en fait des entreprises qui jouent des coudes pour gagner sur le marché du financement. Ce genre de communication scientifique remet en cause le préjugé positif selon lequel l’éducation et la science sont utiles et nécessaires. Elle le remet en cause en devançant le doute qu’inspire l’évolution actuelle.» (…)
Pius Knüsel poursuit :« Les hautes écoles (tout comme les institutions culturelles) doivent se distinguer au niveau régional, national et international. Elles se développent pour devenir des facteurs d’image, des moteurs d’économie régionale. Le politique encourage les partenariats avec l’économie, les chaires financées par des tiers, la rentabilité, des faits politiquement exploitables, des utopies scientifiquement étayées. Les hautes écoles, notamment les HES, suivent joyeusement. Les hautes écoles (tout comme les institutions culturelles) doivent se distinguer au niveau régional, national et international. Elles se développent pour devenir des facteurs d’image, des moteurs d’économie régionale. Le politique encourage les partenariats avec l’économie, les chaires financées par des tiers, la rentabilité, des faits politiquement exploitables, des utopies scientifiquement étayées. Les hautes écoles, notamment les HES, suivent joyeusement. On est prêt à accepter la privatisation silencieuse de cette ressource sociale qu’est l’université. Les discussions autour du sponsoring de l’UBS International Center of Economics à l’Université de Zurich, sur la chaire Swisscom à l’EPFZ ou sur le sens ou le non-sens du Human Brain Project, bâti sur des promesses gigantesques et politiques, témoignent de l’orientation politique du milieu scientifique. Quand elle est plus modeste, la science s’affiche volontiers en partenaire local du politique. «La recherche, en toute situation», tel est le dogme de la communication scientifique. Elle a beau se la jouer sobre, elle est partie prenante de cette transformation de la culture interne des universités et des hautes écoles. Elle rend la science triviale et en fait un concept utilitariste. Elle sape l’idée que la science et la recherche constituent un univers propre, et qu’elles peuvent prétendre à l’incompréhension, aux fausses pistes et à l’absurde; que la science est un système qui ne peut être productif qu’en tant que ressource collective, et qu’elle n’est pas soluble dans des marques compétitives. Je crains que l’identification des citoyens avec le milieu scientifique ne faiblisse, au fur et à mesure que celui-ci évolue vers la culture du spectacle. Cette apparente proximité suscite du scepticisme, la transmission ininterrompue d’informations produit du stress. Les adultes sont capables de saisir l’importance des institutions scientifiques et culturelles pour la société. Qu’on leur prémâche cette importance les contrarie. Que la transmission du message se fasse en usant du niveau d’un journal illustré les irrite. Car rien ne rend le citoyen plus sceptique que la propagande. Or, la majeure partie de la communication scientifique est de la propagande. Elle n’a pas le droit d’évoquer l’échec, seulement les succès. Mais là où la critique et la distance font défaut, la confiance s’effrite. Elle aggrave donc le problème qu’elle entend résoudre en dissimulant une source de connaissance significative: le doute du public. Dans le magazine «Oec» de juin 2014, Josef Falkinger, professeur d’économie financière et de macroéconomie à l’Université de Zurich, cite trois facteurs sur lesquels repose la confiance dans le milieu scientifique: la compétence, l’honnêteté intellectuelle et la conviction qu’il vaut la peine de «se servir de sa raison» et d’«en faire publiquement usage» (Emmanuel Kant). «Il ne s’agit pas, écrit-il, de savoir qui est le meilleur et qui gagne, mais ce que cela finira par donner, en termes de connaissance ou de technique. La confiance baisse avec la multiplication des superlatifs. C’est pourquoi j’interdirais les superlatifs et je stopperais les relations publiques. Ce qui est important se diffuse de toute façon dans la société, grâce à ceux qui appliquent la connaissance, grâce à l’enseignement, à l’intérêt critique des médias pour le milieu universitaire, à l’économie. La communication interuniversitaire est assurée par l’échange au sein de la communauté scientifique. La science n’a pas besoin de l’autocontemplation qui agite le show-biz. Le discours sur la politique de l’éducation existe sans les relations publiques. Pour cela, nous avons des médias indépendants. Que ce discours puisse aussi exprimer des doutes est une question d’honnêteté. Et la critique un signe de scientificité. Ce n’est que comme cela que la science avance, en particulier et en tant que système.»
Il n’y a pas que la science bling-bling qui soit un problème. Les oppositions au Human Brain Project ont aussi porté sur la technolatrie qui le fonde. C’est aussi le sens de la bataille sur l’attribution des crédits qui a tout remis en question. La fronde massive des chercheurs voyait une masse de crédits partir vers la construction d’un ordinateur faustien, alors que ceux destinés à la recherche en neurosciences semblaient passer à la trappe.
Coïncidence, la nouvelle revue d’histoire «Passé simple» vient d’aborder ce dernier problème à partir du cas d’une opération, fascinante au demeurant, de l’EPFL: le scannage des archives médiévales de Venise, qui aboutit à créer une gigantesque basse de données. Nul doute que ce sera très utile. Mais l’Ecole polytechnique a en plus l’ambition, par le traitement informatique de cette incroyable masse de données, de faire de grandes découvertes sur l’histoire de Venise. Justin Favrod illustre les doutes sérieux que l’on peut avoir sur cette prétention technologique en évoquant le cas d’un savant historien de l’Antiquité, Ronald Syme, «qui n’avait que sa tête, sa force de travail et des fiches pour recouper les nombreuses sources écrites de la république romaine finissante.» Il n’en a pas moins écrit un ouvrage magistral sur la mécanique du pouvoir, publié en 1939. Il y a une vingtaine d’années, une base de données informatique a réuni tous les textes littéraires classiques, et d’autres ources. Mais l’oeuvre de Syme reste la référence, la base de données n’a débouché sur rien de comparable.
La technolâtrie est un mal de l’époque. Elle peut rendre la science inopérante, ou dangereuse.




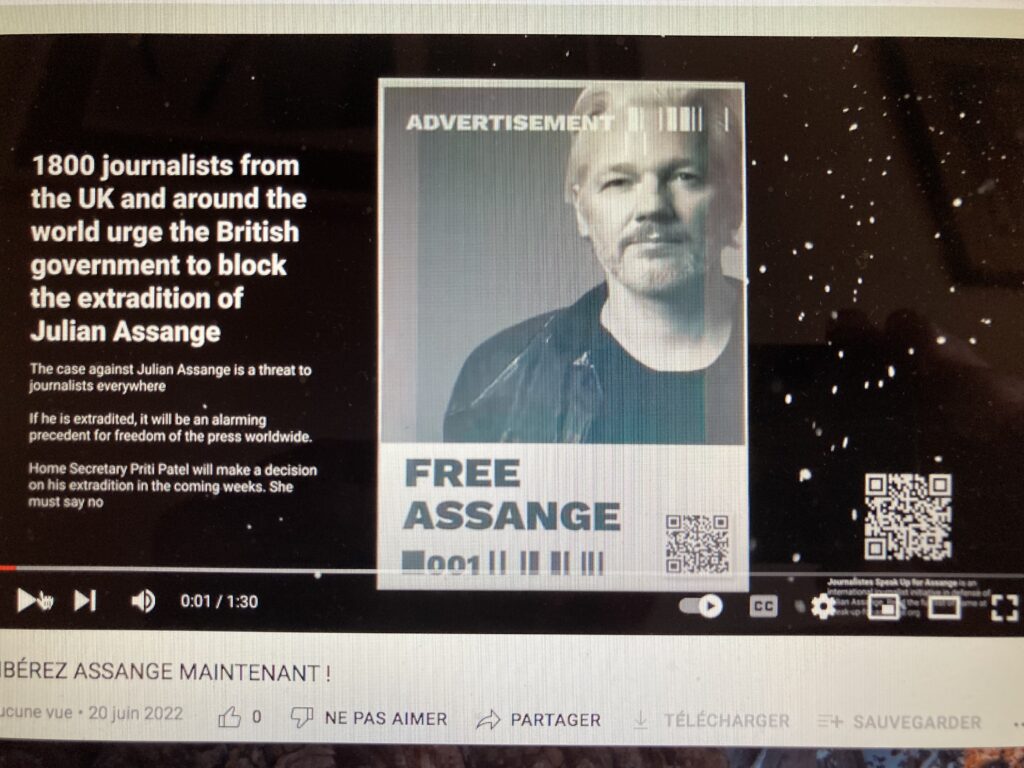


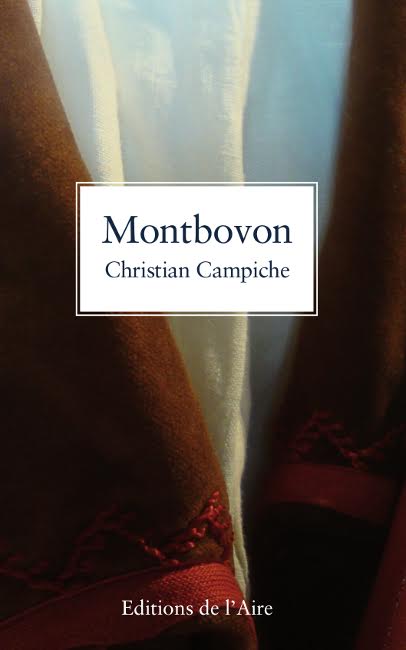


Contester la Science? Mais Môssieur, qu’allez-vous raconter? Délit de lèse-majesté!
Je crains que l’identification des citoyens au milieu scientifique ne faiblisse au fur et à mesure que celui-ci évolue vers la culture du spectacle.